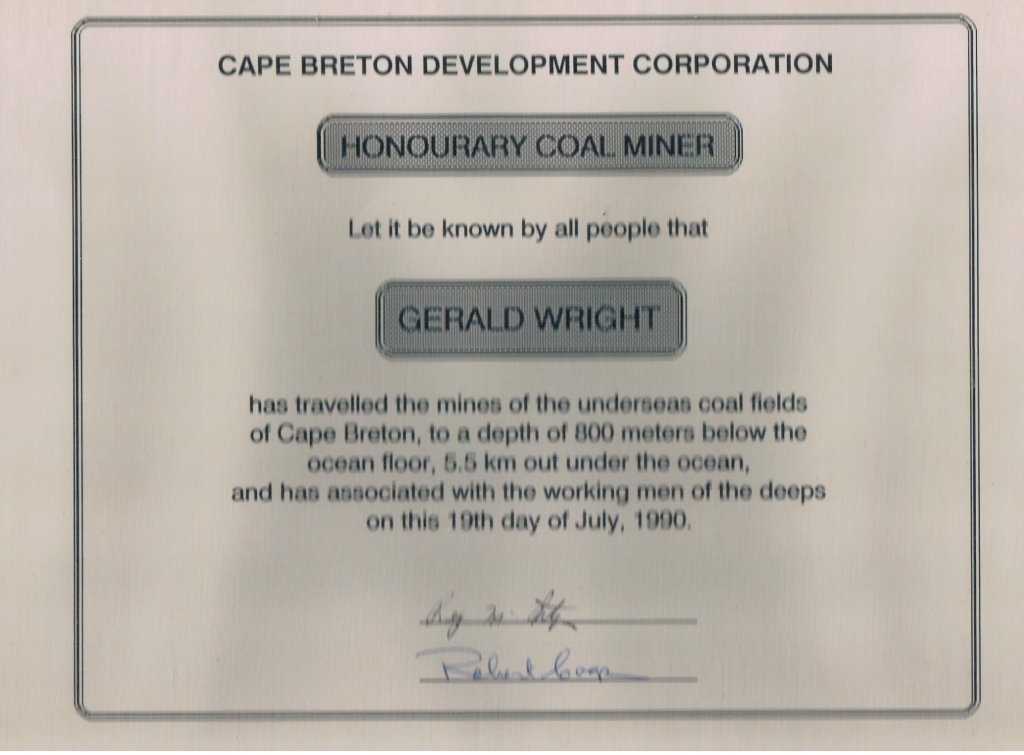This is the sixth of a six-part auto-biographical series about the Cape Breton Development Corporation (DEVCO) by Gerald Wright, who was from 1989 to 1992 a senior policy advisor to the federal minister responsible for DEVCO.
Tragedy struck at 5:18 a.m. on Saturday, May 9, 1992, when a methane-ignited coal dust explosion shook the Westray Mine. I was immediately sent on a fact-finding mission to DEVCO’s head office so that if questions were asked in the Commons about the safety of workers in the government-owned mines the minister would be ready with answers. Executives met me with a list of rules and procedures in force at the company. They made it clear that, as far as they were aware, many of the same rules and procedures were being flouted by Westray.
A DEVCO submission to the governments of Canada and Nova Scotia in December 1987, arguing against going ahead with Westray, had stated that the Pictou coalfield’s “seams have given off large volumes of gas and (have) proven extremely liable to spontaneous combustion.”[1] The owners’ rush to production had sounded more alarm bells. Throughout 1991 there were reports from provincial inspectors and private consultants expressing concern about methane gas levels, improper storage of flammable materials and the use of unauthorized equipment.[2] A vigilant union should have forced more attention to safety, but the United Mine Workers had lost a bid to organize Westray workers and the United Steelworkers were just two weeks into an organizing drive at the mine.
The inquiry into the disaster would later conclude that it was “a story of incompetence, of mismanagement, of bureaucratic bungling, of deceit, of ruthlessness, of cover-up, of apathy, of expediency, and of cynical indifference.”[3]
A matter of hours after the explosion, four of DEVCO’s mine rescue experts were on the scene. They were followed by six teams of DEVCO’s draegermen[4] and a technical support team. Finance Vice-President Merrill Buchanan became my hourly briefer. At times I was transmitting information to the Minister on Parliament Hill, who would see that it was passed to the Prime Minister. There was still hope that the twenty-six miners entombed underground would be recovered alive.
In the end, however, hopes were dashed. As Thursday, May 14 dawned, there was no sign of life in the mine and dangers were mounting for the draegermen. The world stood still as I heard the decision to suspend the search, with sixteen bodies recovered or identified[5] and ten men still missing.
Continue reading